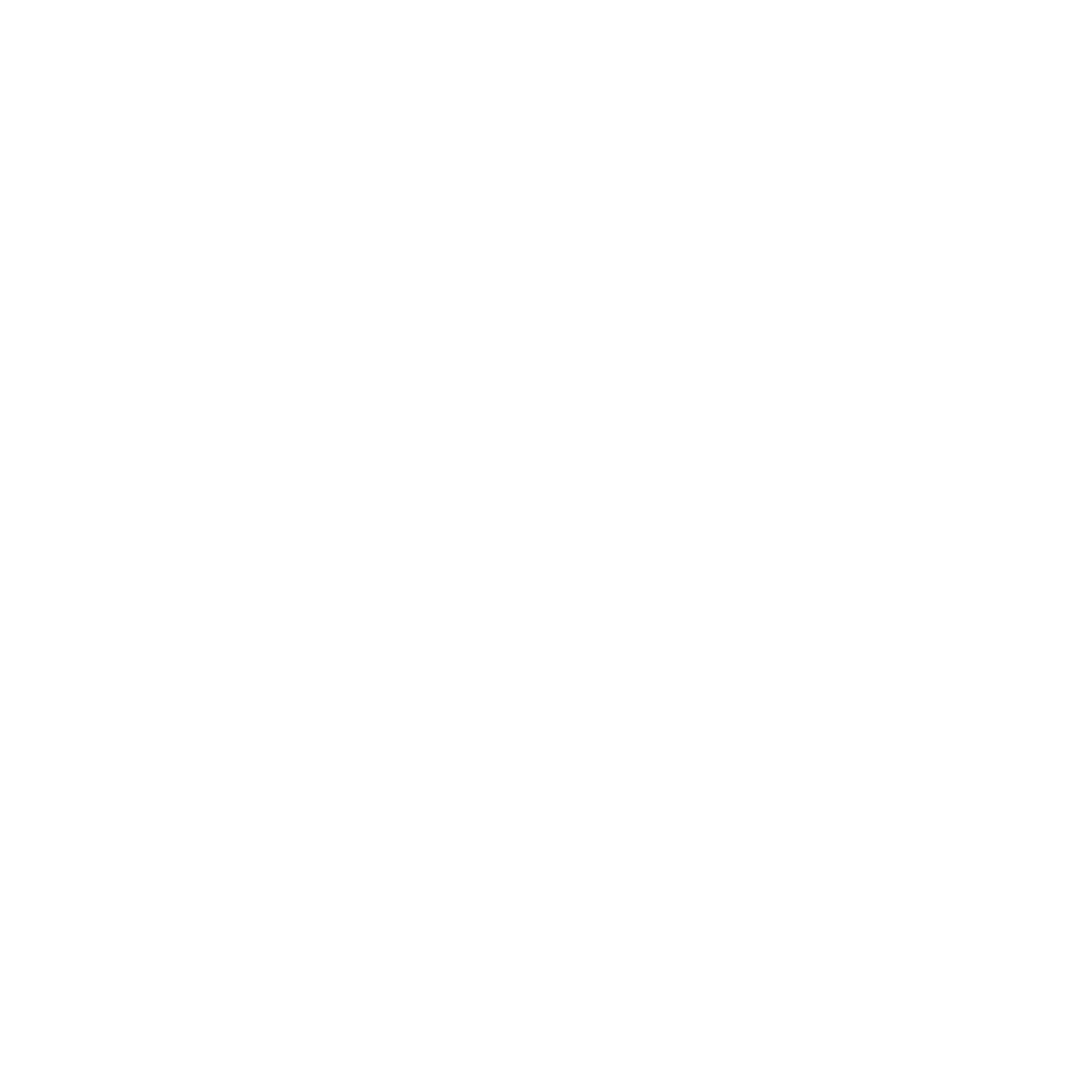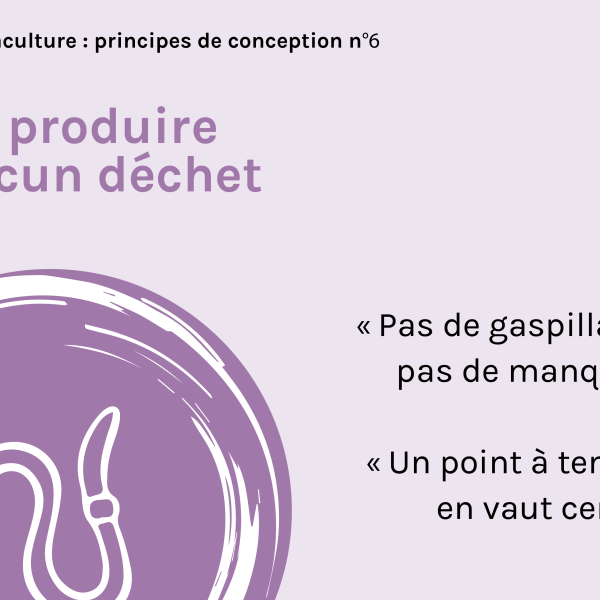Avant de se lancer tête baissée dans des projets de jardinage ambitieux, il est essentiel de prendre le temps d’observer son terrain. Une année complète d’observation, à travers les quatre saisons, permet de comprendre les spécificités de votre jardin : ensoleillement, composition du sol, écoulement de l’eau et plantes déjà en place. Cette démarche patiente et attentive vous aidera à éviter les erreurs coûteuses et à créer un espace vert harmonieux et florissant. Dans cet article, nous explorerons l’importance de cette phase d’observation et les meilleures pratiques pour en tirer le maximum d’enseignements.
Attendre avant de commencer : la patience récompensée
Avant de planifier des gros travaux ou des changements importants sur votre terrain, il est fortement conseillé d’attendre un an et de vivre les quatre saisons afin de recueillir un maximum d’informations. Cela vous évitera bien des erreurs. Pour les impatient·es qui viennent d’acheter une maison, cette pause dédiée à l’observation est bénéfique pour se ressourcer, prendre le temps de s’installer chez soi et éviter les dépenses supplémentaires hâtives. Votre portefeuille, déjà en souffrance après les frais d’acquisition, vous en remerciera !
Bien sûr, si vous êtes dans votre habitation depuis un moment, il n’est pas nécessaire d’attendre aussi longtemps avant de débuter des travaux. La première année après avoir fait l’acquisition de notre propriété n’a pas été très reposante. Nous avons consacré beaucoup de temps (et d’argent) à faire des modifications à l’intérieur de la maison et à acquérir de l’équipement pour l’entretien. La cour arrière n’était pas notre priorité.
Priorités et exceptions : savoir par où commencer
Il y a quelques exceptions à cette règle d’attendre. Par exemple, si vous venez d’acquérir un terrain et que vous savez d’emblée que vous n’allez pas garder certains éléments, enlevez-les avant de vous y attacher (réfléchissez-y quand même à deux fois) ! Ça peut aller d’un vieux chemin pavé mal placé à une sculpture ou un objet décoratif qui n’est pas à votre goût, en passant par un énorme rocher posé sur le sol qui occupe le seul endroit complètement ensoleillé de votre espace.
Avant même de commencer la transformation de notre cour arrière, il y avait quelques travaux que nous estimions prioritaires : retirer un grand et vieux sapin malade ainsi que deux souches d’arbres, mais aussi deux très jeunes sapins, car nous avions déjà suffisamment de conifères pour nous faire de l’ombre. Nous voulions également installer une clôture pour diviser l’avant et l’arrière de notre terrain pour notre chien. Comme tout débutant, nous avons été impatients et, dès le premier printemps, nous avons déplacé le potager qui était situé dans une zone complètement ombragée pour le mettre dans un endroit qui nous paraissait un peu plus ensoleillé.
Apprendre de ses erreurs : leçons de jardinage
Plus tard, nous avons constaté que la nouvelle zone choisie pour le potager n’était pas la mieux adaptée pour des légumes. Oui, elle était au soleil le matin et au printemps, quand il n’y avait pas encore de feuilles dans les arbres, mais en plein été, l’ensoleillement y était très réduit à cause de la proximité de gros érables qui produisaient une ombre complète à partir de midi jusqu’en soirée. Il aurait mieux valu prévoir un plan d’ensemble avant de déplacer le potager, voilà la punition pour ceux qui ne savent pas attendre…
Par contre, nous avons décidé de conserver certains autres éléments sur le terrain, notamment une grosse souche d’érable utilisée par de nombreux insectes. Pour l’embellir, nous y installons à chaque printemps une décoration faite à partir de matériaux recyclés (libellule en bois et en métal). Nous avons aussi gardé tous les arbres matures et en bonne santé ainsi que les très hautes et très épaisses haies de thuyas (communément appelées « haies de cèdres » au Québec), même si elles nous donnent du travail de taille chaque année. Elles servent de délimitation et de « brise-vue » avec les voisins. Elles sont aussi de très bons coupe-vent et fournissent un abri pour de nombreux animaux, comme les oiseaux qui nichent à l’intérieur à chaque printemps.
Observer et identifier les plantes existantes : un travail d’enquête
Cette année d’observation sera l’occasion d’acquérir ou d’approfondir vos connaissances en botanique. Vous devrez d’abord identifier les espèces qui sont déjà présentes sur votre terrain. C’est toujours utile de savoir lesquelles sont envahissantes, toxiques ou allergènes. L’identification des plantes vous permettra également de décider ce que vous voulez en faire : les garder et planifier votre aménagement autour d’elles ? Les retirer de votre terrain complètement ? Les replanter ailleurs ?
Pour identifier les plantes qui vous sont inconnues ou sur lesquelles vous avez des doutes, vous pouvez consulter votre entourage si un membre de votre famille ou un ami a des connaissances dans le domaine. Si vous n’avez pas ce genre de ressources autour de vous, il existe différents outils. Qu’elles soient gratuites ou payantes, certaines applications sur téléphone peuvent vous aider à ce sujet, mais je vous conseille surtout de vous inscrire à des groupes de passionné·es de jardinage sur les réseaux sociaux. Il existe toutes sortes de groupes de discussion : des groupes locaux, régionaux ou pour le Québec tout entier, voire pour le monde francophone, ou encore des groupes spécialisés dans certaines familles de plantes (arbres et arbustes fruitiers du Québec, agrumes, jardins potagers, forums de jardinage, permaculture, etc.).
Enfin, certains sites internet ou certains livres ont des systèmes de clés d’identification qui sont bien utiles pour éliminer certaines espèces quand vous faites votre recherche, surtout lorsqu’il s’agit d’arbres. Et puis, vous savez quoi ? Si vous n’arrivez pas à déterminer précisément la variété ou le cultivar d’une plante, cela n’a pas tant d’importance que ça, tant que vous avez une idée générale de son comportement (invasif ou pas) et de l’ombrage qu’elle projettera aux alentours.
Caractéristiques utiles à connaître
Les caractéristiques utiles à connaître pour une plante déjà présente sur votre terrain, en dehors de la floraison et de la forme du feuillage, sont les suivantes :
- Est-ce qu’elle repart à la base du sol à chaque printemps (vivace) ? Si non, c’est une plante considérée comme une annuelle dans votre climat.
- Est-ce que la plante est ligneuse (produit-elle des branches qui deviennent dures et généralement brunes) ? Si oui, il s’agit d’un arbuste ou d’un arbre.
- Est-ce que la plante perd ses feuilles à l’automne (caduque) ? Ou, au contraire, est-ce qu’elle les conserve tout l’hiver (feuillage persistant comme les conifères) ?
- Est-ce que l’arbre ou l’arbuste projette une ombre dense ou plutôt légère autour de lui ?
- Est-ce que la plante produit des fruits et ceux-ci sont-ils comestibles pour les humains ou utiles pour la faune ?
Une fois que vous connaissez ces caractéristiques, vous pouvez plus facilement trouver le nom de la plante. Essayer d’identifier une plante quand elle commence tout juste à repousser ou qu’elle a déjà perdu toutes ses feuilles peut s’avérer compliqué. Une fois la plante identifiée, vous pourrez vous renseigner sur son milieu favori (ensoleillement, humidité et fertilité du sol), sa taille à maturité ainsi que sur ses comportements particuliers. Si vous voyez que la plante a l’air bien épanouie, vous pouvez supposer que votre environnement comble assez bien ses besoins. Si, par contre, votre plante est chétive ou atteinte par des parasites ou des maladies, il est possible que son milieu de vie ne soit pas adapté à ses besoins.
Relocalisation des plantes : un choix stratégique
Par exemple, la lavande aime les sols secs et pauvres en plein soleil, et elle risque d’avoir mauvaise mine à l’ombre dans un sol humide. Lorsque vous constatez que la plante n’est pas en bonne santé, vous pouvez décider, lors de la phase de conception de votre aménagement, de la relocaliser sur votre terrain à un endroit plus adapté pour elle. Autrement, vous pouvez vous en défaire en la donnant à quelqu’un d’autre ou en la jetant tout simplement dans votre compost. Une plante qui n’est pas heureuse là où elle se trouve vous donnera généralement beaucoup de difficultés, car elle aura régulièrement besoin d’aide (engrais, traitements pour les insectes et maladies, etc.). À vous de prendre la bonne décision sur son avenir, en tenant compte du temps, de l’énergie et de l’argent que vous voulez dépenser pour elle.
Avec les renseignements que vous récolterez dans votre liste d’espèces présentes sur votre terrain, vous aurez déjà une idée de votre sol et de l’ensoleillement, qui sont deux des paramètres à observer, comme je vais l’expliquer dans les prochaines sections. Attention, si vous avez un arbre qui produit des noix, il faudra veiller à identifier l’arbre, car la plupart des noyers sécrètent une substance appelée « juglone » qui peut nuire au développement de certaines plantes situées à proximité. Ce sont surtout les noyers noirs et les noyers cendrés qui produisent de grandes quantités de juglone. Si vous avez l’une de ces deux espèces sur votre terrain, vous devrez chercher des plantes qui résistent bien aux effets de cette substance si vous souhaitez en planter autour de vos arbres.
Ensoleillement : un facteur clé
Le deuxième paramètre dont il faut tenir compte durant cette année d’observation est l’ensoleillement de votre terrain. Essayez de déterminer les emplacements qui sont les plus ensoleillés, ceux qui se retrouvent à la mi-ombre et ceux qui sont tout le temps à l’ombre. Cet exercice est essentiel si vous comptez implanter une zone de potager ou de jardin-forêt. Faites-le également si vous voulez simplement planter quelques arbustes ou arbres fruitiers, car ce sont majoritairement des espèces qui aiment le soleil, même si certaines d’entre elles peuvent s’accommoder ou apprécier des conditions mi-ombragées.
Gardez en tête que, de façon générale, moins une plante reçoit de soleil et moins elle aura accès à la principale source d’énergie qui lui permet de faire de la photosynthèse et de produire de la matière verte (les branches et les feuilles). Avec les fruitiers, le manque de lumière affecte aussi leur production de fleurs, le développement de leurs fruits et même la qualité de ceux-ci (couleur, goût, grosseur). Les fruitiers seront aussi plus sensibles aux maladies et à l’attaque de parasites s’ils n’ont pas un niveau d’ensoleillement qui correspond à leurs besoins.
Quand il est question d’ensoleillement, il faut aussi tenir compte du changement entre les saisons.
La durée d’ensoleillement va varier selon la longueur du jour, la météo, mais aussi selon les ombres projetées au sol par les arbres. Ces ombres seront plus courtes lors du solstice d’été (21 juin) et plus longues durant les autres périodes de l’année. De plus, l’ensoleillement peut varier au cours de la même saison, selon le type de plante qui fait de l’ombrage. Si vous avez un arbre caduc (qui perd ses feuilles à l’automne) et qui met longtemps à reverdir au printemps, vous pourriez par exemple envisager de faire pousser des cultures annuelles rapides au nord de cet arbre tôt au printemps, avant que ses feuilles ne repoussent totalement.
Planifier en fonction de l’ensoleillement
On peut citer le cas du févier d’Amérique, dont les feuilles mettent beaucoup de temps à pousser au printemps, et celui des cultures annuelles printanières, telles que les radis ou les épinards qui peuvent être récoltés avant la fin de la feuillaison de l’arbre. Mais beaucoup de plantes tolérant la mi-ombre pourront s’accommoder d’être situées au nord d’un févier ou d’autres arbres ayant des feuilles fines, car leur ombre reste légère par rapport à celle d’un érable, par exemple.
Si vous avez une épinette ou un sapin (de la famille des conifères qui ne perdent pas leurs aiguilles en automne), vous savez que toutes vos plantes au nord de sa ramure n’auront que quelques heures de soleil le matin et le soir en été, et pratiquement aucun soleil direct en début et en fin de saison, puisque l’ombre du conifère s’étirera. Je vous suggère de faire un petit croquis de votre terrain indiquant l’emplacement de votre maison et des différentes structures attenantes, comme le garage et les arbres qui font de l’ombre permanente. Reproduisez ensuite ce croquis en plusieurs exemplaires et amusez-vous à faire une carte d’ensoleillement sommaire du terrain à différentes saisons.
Prenez soin de vérifier, sur une journée ensoleillée complète, quelles sont les zones de votre terrain qui sont en plein soleil (8 heures par jour minimum), les zones de mi-ombre (4 à 8 heures de soleil par jour) et les zones ombragées (moins de 4 heures de soleil par jour). Cet exercice mérite d’être fait au début et à la fin de chaque saison de croissance et de floraison (printemps, été et automne).
Observer le réchauffement du sol
En plus de l’ensoleillement saisonnier, il est important de tenir compte du réchauffement du sol provoqué par le soleil au printemps, notamment lorsque la neige fond. S’il y a possibilité de gel tardif au printemps, la petite astuce à connaître pour s’assurer que l’emplacement choisi pour vos arbres fruitiers est correct est la suivante : observez bien où la neige fond le plus vite au printemps ; les premières pousses de vivaces et d’herbes apparaîtront en premier dans ces zones, car la terre s’y réchauffe plus vite qu’ailleurs.
Ne plantez pas vos arbres fruitiers sensibles au froid à ces endroits, car ils risquent de se réveiller plus tôt que les autres qui sont encore enneigés. Les bourgeons commenceraient alors à grossir et à s’ouvrir (certains pourraient même se mettre à fleurir) et il suffirait qu’un gel tardif survienne pour que ce soit la catastrophe ! Si les bourgeons floraux ou même les fleurs gèlent, votre récolte risque en effet d’être perdue ou grandement diminuée cette année-là.
Il existe cependant des moyens de réduire le risque de gel des bourgeons.
À petite échelle, on peut envelopper les bourgeons ou les fleurs de couvertures légères à l’annonce du gel ou, pour les petits spécimens, les recouvrir d’un pot en plastique ou d’un cône protecteur en polystyrène ou en styromousse. À plus grande échelle, plusieurs techniques sont employées, notamment par les agriculteurs. Par exemple, on peut asperger en continu les plantes avec de l’eau, ce qui va créer une belle pellicule de glace sur les bourgeons et les protéger du froid de l’air ambiant. On peut aussi faire des feux à proximité, des brûlots, pour réchauffer l’air. Il faut toutefois les entretenir pendant toute la durée du gel sévère. Et aux grands moyens les grands remèdes, des hélicoptères peuvent tourner en continu au-dessus des cultures, ce qui a pour effet de brasser l’air et d’augmenter de quelques degrés la température au sol !
Quand un agriculteur ou une agricultrice vit de sa production, toutes ces techniques pour protéger ses récoltes futures ont du sens. Pour un particulier, outre la couverture qui peut être facilement mise en place si votre arbre n’est pas déjà trop grand, la technique d’aspersion est aussi utilisée. Mais disons qu’il faut être motivé pour entreprendre ces opérations à une période où il fait encore froid et où votre système d’irrigation est peut-être encore fermé pour la saison.
Concevoir votre aménagement différemment
Une solution plus facile et nécessitant beaucoup moins d’efforts est de concevoir votre aménagement différemment.
Si la configuration de votre terrain vous le permet, essayez de garder vos arbres sensibles au gel printanier en dormance le plus longtemps possible, en les plantant au nord de votre terrain, où l’ensoleillement est moins optimal en début de saison. Cette zone met normalement plus de temps à se réchauffer que la zone au sud, en raison du soleil qui est plus bas en hiver. Si vous n’avez pas la possibilité de planter vos arbres sensibles au gel à cet emplacement, vous pourrez atténuer les dégâts au printemps en leur mettant une épaisse couche de paillis à l’automne. Cela aura pour effet de retarder le réchauffement du sol qui déclenche le réveil des bourgeons. Au besoin, vous pouvez aussi rajouter de la neige à leur pied lorsque la neige qui y est déjà présente commence à fondre.
L’écoulement de l’eau : comprendre le terrain
Une autre observation utile à faire est de déterminer le sens de l’écoulement de l’eau sur votre terrain. Prenez le temps de regarder si l’eau a tendance à s’accumuler à certains endroits. Cela peut être dû à un creux ou à une dépression dans le terrain, qui s’accentue en présence d’un sol argileux, car celui-ci met du temps à absorber les précipitations. Mais si l’eau reste très longtemps, surtout à la fonte des neiges, cela peut également signifier que le drainage du terrain est mauvais. Il faudra alors rétablir des pentes efficaces qui permettent à l’eau de s’écouler naturellement vers l’extérieur ou bien installer un système de drain souterrain à certains endroits.
Cela peut aussi signifier que le niveau de la nappe phréatique qui passe sous cet endroit est proche de la surface. Les plantes plus massives, telles que les arbres, ont des racines qui risquent d’atteindre la nappe phréatique rapidement et de se retrouver alors en contact permanent avec l’eau. Cela aurait pour conséquence de provoquer une asphyxie et une pourriture des racines.
S’il y a un puits chez vous ou chez vos voisin·es et que vous vous renseignez sur sa profondeur, vous aurez une bonne idée de l’endroit où se trouve la nappe phréatique. Si tous les voisins ont des puits artésiens, alors la nappe phréatique est sûrement suffisamment profonde pour ne pas nuire aux plus grands arbres fruitiers qui peuvent avoir des racines s’enfonçant de 4 à 6 mètres de profondeur. Si, par contre, votre voisin a un puits de surface creusé à seulement quelques mètres de profondeur, il est fort possible que certains arbres fruitiers ayant des racines profondes soient affectés et meurent s’ils sont plantés trop près. À vous de déterminer les endroits les plus appropriés sur votre terrain pour la culture d’arbres fruitiers.
Aménager des talus et des rigoles
Si vous avez un terrain en pente (ici, on exclut les pentes raides) et que vous constatez qu’il y a un ruissellement important lors des précipitations, surtout lorsque votre sol est sec, alors votre objectif sera de retenir au maximum l’eau sur votre terrain. Le but est de mettre cette ressource à disposition de vos plantes et d’éviter qu’elle cause de l’érosion et lessive vos nutriments à la surface. Dans ce cas, une technique largement employée par la permaculture est la création de talus et de rigoles. Ces talus et rigoles sont position
nés perpendiculairement à vos pentes, à des endroits stratégiques qui suivent les contours du terrain. La rigole collecte l’eau comme un bassin de captage et le talus positionné en aval de la rigole facilite l’infiltration lente de l’eau dans le sol. Les arbres et les plantes à proximité, essentiels pour la réussite de cette technique, prélèvent cette eau infiltrée. Cet aménagement, qui n’est toutefois pas approprié pour les terrains très en pente, limite grandement l’érosion du sol tout en utilisant l’eau directement sur le terrain.
Si le ruissellement est surtout provoqué par l’écoulement des toits des bâtisses plutôt qu’à cause d’une pente, vous pouvez récupérer cette eau en la détournant dans des récipients tels que des cuves, qu’ils soient enterrés ou non. Pour tous travaux de drainage ou de modification substantielle de la topographie (c’est-à-dire du relief) de votre terrain, je vous recommande de faire affaire avec un professionnel si vous n’avez aucune expérience en la matière. En effet, vous risquez d’empirer le problème si les travaux ne sont pas réalisés correctement.
La topographie du site
Relevez les différents reliefs présents sur votre propriété : pentes, creux, plateaux. Notez qu’il est normal et même souhaitable qu’une pente faible soit présente tout autour de votre maison, elle sert à éloigner l’eau de vos fondations. Si votre terrain le permet, est-ce que vous souhaitez y aménager des terrasses, des rocailles ou y ajouter des escaliers ? J’envie les gens qui ont des dénivellations marquées sur leur terrain, car ils peuvent s’amuser à jouer avec les hauteurs et les points de vue plus facilement que dans notre cas, où le terrain est complètement plat. J’imagine que si les gens ont des terrains tout en pente, ils doivent tout autant envier les propriétaires de terrains plats !
L’intérêt d’identifier les reliefs a d’abord pour but de concevoir un aménagement harmonieux.
Pour le choix des plantes, il faut prendre en compte le relief qui peut créer de l’ombre et adapter la dimension des plantes pour que certaines ne cachent pas les autres. Lorsqu’on aménage une cuvette ou un creux sur le terrain, il est important de planter la variété de végétaux la plus grande dans le fond de la cuvette et de répartir les plus petites variétés sur les côtés. La présence d’une cuvette ou d’une vallée sur un grand terrain signifie que l’air froid qui s’y engouffre naturellement pourra s’accumuler au fond, s’il n’a pas moyen de s’en échapper.
Ce phénomène peut provoquer des gels à cet endroit sans que le reste du terrain soit touché. Il est parfois possible d’ouvrir ces cuvettes en dégageant ce qui empêche l’air froid de repartir. Ainsi, on peut éclaircir une haie ou des arbres à la sortie de la cuvette dans la direction du vent. Ou, au contraire, on peut empêcher le vent de s’y engouffrer en travaillant en amont avec un système de brise-vent.
La composition physique et chimique du sol
La composition d’un sol varie en fonction de sa texture ainsi que de ses composants chimiques qui sont aptes à nourrir la plante et à lui procurer un environnement favorable. Il faut comprendre que chaque plante a des besoins spécifiques pour pouvoir croître de manière optimale. En lui procurant les conditions qui lui conviennent dès le début, elle vous remerciera en vous demandant très peu d’attention. Une plante qui pousse dans des conditions adaptées à ses besoins s’épanouira sans que vous n’ayez quoi que ce soit à faire la plupart du temps. Bien sûr, une condition essentielle est le temps d’ensoleillement dont elle a besoin. Néanmoins, il ne faut pas sous-estimer un autre critère essentiel pour sa croissance : la composition du sol.
Est-ce que votre plante aime les sols sablonneux, limoneux ou argileux ?
Heureusement, les plantes s’accommodent souvent de plusieurs types de sol, mais certaines s’adaptent particulièrement bien à un sol imparfait. Est-ce que votre plante aime un sol riche ou plutôt un sol pauvre ? A-t-elle besoin d’un sol acide, plutôt neutre ou bien basique/alcalin ? Voilà les quelques questions à vous poser sur la composition de votre sol afin de vous aider à sélectionner vos plantes. En effet, il est plus facile de sélectionner des variétés qui s’adaptent bien à votre sol que de modifier votre sol et l’adapter aux variétés que vous souhaitez planter. Un sol a tendance à revenir naturellement à son état d’origine en ce qui concerne le niveau d’acidité (pH). Par conséquent, il faut régulièrement l’amender, c’est-à-dire y rajouter des produits et des matières, si l’on souhaite le maintenir dans son état modifié.
Il est important de savoir que la culture de la plupart des fruitiers requiert des apports de matières organiques sur une base régulière (annuelle) pour nourrir la plante et optimiser les récoltes de fruits. Ce n’est pas forcément le cas des autres plantes comestibles plus « sobres » en nutriments, qui n’ont pas besoin de produire des fruits.
La texture du sol
Il existe quelques tests faciles à effectuer soi-même pour avoir une bonne idée de la composition de son sol.
Le premier est le test du bocal d’eau qui vous dira si votre sol est plutôt sablonneux, limoneux, argileux ou si c’est du loam (un mélange des trois en bonne proportion). Le loam est un type de sol ideal pour faire des cultures potagères. Le loam est une classe texturale composée de moins de 50 % de sable, 30 à 50 % de limon et de 5 à 25 % d’argile. Selon les proportions, on parlera de loam sablonneux, limoneux ou argileux. Le loam est idéal pour l’agriculture car il est à la fois drainant et conserve bien l’humidité.
Je vous conseille de faire le test du bocal à différents endroits de votre terrain, là où vous prévoyez faire des plantations.
En effet, on connaît rarement tout l’historique d’un terrain lorsqu’on en fait l’acquisition et on ne sait pas ce qui a pu se passer sur certaines zones spécifiques. On a peut-être rempli certains endroits avec de la terre de remblais, souvent de mauvaise qualité pour la culture. Sans compter que la composition du sol peut fluctuer naturellement sur un même terrain.
Pour faire le test, prenez un bocal transparent, puis creusez et prélevez 1 à 2 tasses de sol dans les 30 premiers centimètres. Ajoutez du sel (2 cuillères à thé environ) et remplissez-le d’eau. Secouez énergétiquement pour que le sel se dissolve. Cela aide à séparer les différents composants de votre sol. Reposez le bocal et n’y touchez plus pendant au moins 24 heures, voire plus si l’eau est encore trouble. Les particules fines d’argile peuvent mettre beaucoup de temps avant de se déposer.
Les particules se formeront en différentes couches selon leur grosseur : le sable, qui est l’élément le plus grossier, se déposera rapidement au fond. La couche suivante sera composée de sable fin, puis de limon. La dernière couche, composée de particules d’argile, se superposera sur toutes les autres, car ces particules sont très fines. Quant à la matière organique, elle va simplement flotter à la surface, ou se déposer sur l’argile si les impuretés sont plus lourdes.
Vous pouvez maintenant calculer les proportions de chaque couche et déterminer quel type de sol vous avez.
Si l’une des couches est quasiment absente et que vous hésitez entre deux composants (par exemple, de l’argile ou du limon), prenez un peu de terre à l’endroit que vous voulez identifier et essayez de vous fier à la texture de la terre entre vos doigts :
- Sable : on voit les grains à l’œil nu. Si le sable est grossier, il va gratter les mains et glisser entre vos doigts. S’il est humide, il sera impossible d’en faire une boule entre vos mains, car celle-ci va s’effriter.
- Limon : sorte de poudre quand il est sec, il est doux au toucher et tache facilement les doigts. Une fois humide, il devient glissant mais collant. Il est difficile d’en faire des boules sans qu’elles ne se brisent facilement.
- Argile : va former des mottes de terre très compactes et difficiles à briser quand elle est sèche. Une fois humide, elle colle aux mains et aux outils. On peut facilement former des boules compactes avec de l’argile.
Adapter la texture du sol à vos besoins
La texture de la terre fera varier les conditions de vie pour vos plantes.
Une terre sablonneuse a pour conséquence un sol très perméable, avec une faible réserve en eau et en nutriments. En effet, la terre sablonneuse ne retient pas l’eau de pluie ou d’arrosage, qui s’infiltrera très rapidement dans le sous-sol. De manière générale, les plantes dans une terre sablonneuse ont besoin de recevoir de l’eau plus fréquemment puisque le terrain s’assèche très vite. Elles ont tendance à étendre leur système racinaire plus loin, pour maximiser la surface où puiser tous les nutriments qu’elles peuvent quand elles reçoivent de l’eau.
Un sol argileux, en contrepartie, a du mal à évacuer rapidement les eaux de pluie en profondeur à cause des particules très fines d’argile qui se collent les unes aux autres et empêchent l’eau de passer facilement. On connaît bien le ruissellement de l’eau de pluie à la surface d’un terrain argileux lorsque la pluie tombe sur un sol sec. L’eau s’écoulera à la surface dès qu’il y aura une pente sur votre terrain. L’eau stagnera aussi beaucoup plus longtemps avant de pouvoir s’infiltrer dans le sol, ce qui peut rendre votre terrain boueux. Les racines des plantes peuvent avoir des difficultés à s’étendre dans le sol (surtout quand il est sec) puisque l’argile peut agir comme une barrière impénétrable.
Un sol argileux a tout de même quelques avantages par rapport au sol sablonneux : il garde une réserve d’eau beaucoup plus longtemps et sera par conséquent plus riche en nutriments qu’un sol sablonneux.
L’enjeu est de réussir à rendre ces nutriments disponibles pour les plantes en améliorant progressivement la structure du sol.
En y ajoutant du compost et du fumier régulièrement, à faible profondeur, du humus se formera et les nutriments deviendront beaucoup plus accessibles aux plantes. Afin d’augmenter la cohésion entre l’humus et l’argile, il est nécessaire d’ajuster le calcaire, en appliquant de la chaux au besoin.
Pour sa part, un sol riche en limon formera souvent une croûte imperméable à l’air et à l’eau en se tassant en surface lorsqu’il y a de la pluie (ce que l’on appelle le phénomène de battance), surtout s’il y a peu de matières organiques. Si ces sols sont humides, les machines et les équipements lourds leur causent particulièrement des dommages. La meilleure stratégie est donc de les enrichir avec de la matière organique, par exemple en disposant des copeaux de bois à leur surface.
En conclusion : observer pour mieux jardiner
En résumé, prendre le temps d’observer votre terrain avant de vous lancer dans des travaux ou des changements majeurs est essentiel pour réussir votre projet de jardinage.
Vous apprendrez à connaître les spécificités de votre sol, l’ensoleillement, l’écoulement de l’eau et les plantes déjà présentes. Cette année d’observation vous permettra de faire des choix éclairés et d’éviter les erreurs coûteuses. Votre jardin n’en sera que plus beau et plus sain, et vous aurez le plaisir de voir vos plantes s’épanouir dans des conditions optimales. Alors, prenez votre temps, observez, et laissez-vous inspirer par la nature qui vous entoure !
Shark FlexBreeze Pro Mist Ventilateur intérieur/extérieur sans fil, Brumisateur portable, Portée 20 m, Sur pied ou de table, 5 vitesses, Silencieux, Télécommande, Gris Charbon FA300EU
8% de réductionKESSER® Store banne avec manivelle pour Balcon | Store pour Balcon sans Trous à percer, résistant aux UV, réglable en Hauteur, Hydrofuge, protège du Soleil, Toit de terrasse (400cm, Anthracite)
Now retrieving the price.
(as of juillet 5, 2025 14:40 GMT +00:00 - Plus d’infosProduct prices and availability are accurate as of the date/time indicated and are subject to change. Any price and availability information displayed on [relevant Amazon Site(s), as applicable] at the time of purchase will apply to the purchase of this product.)