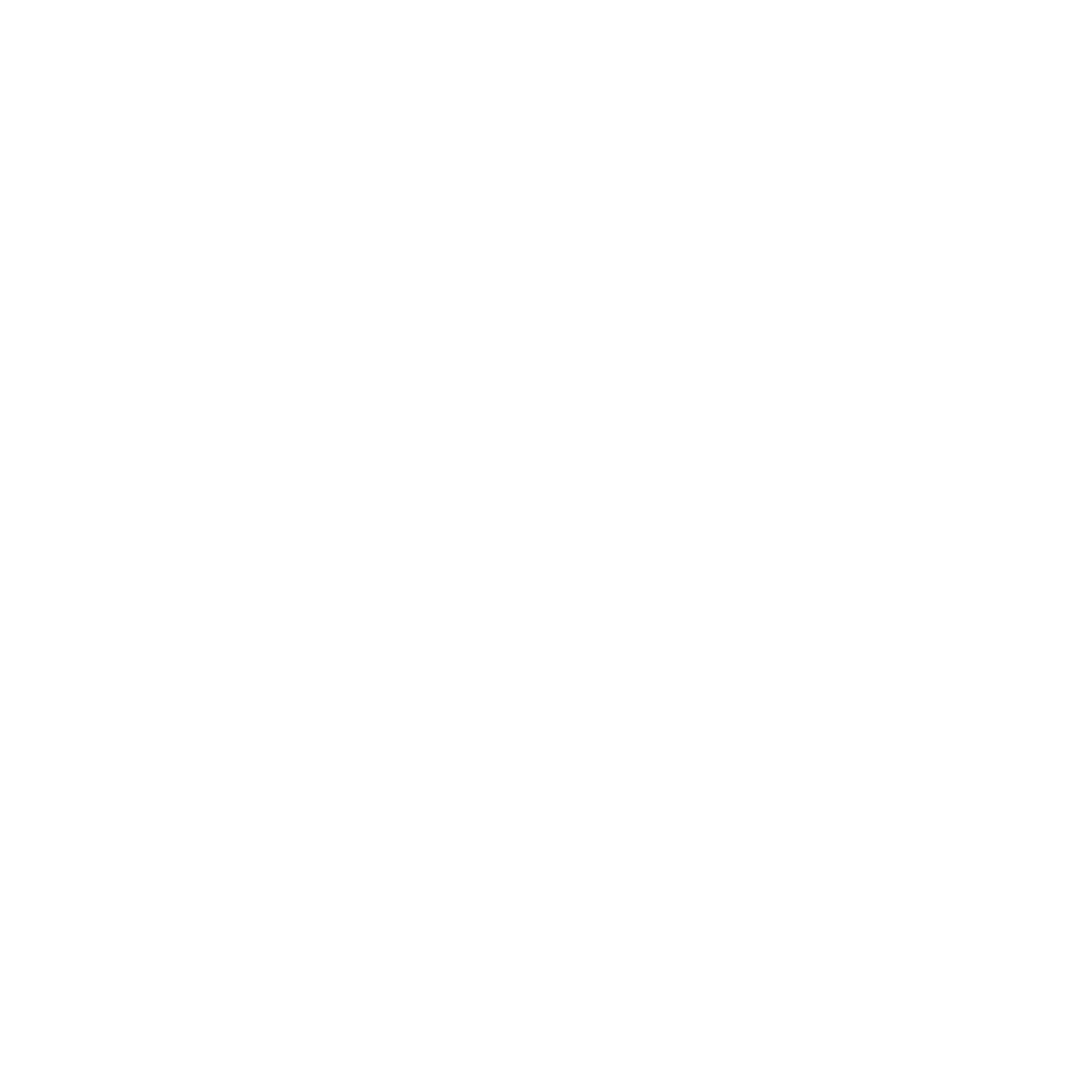Niché dans la commune d’Elsfleth, en Basse-Saxe, le Garten Moorriem s’étendait sur environ 10 000 m². Ce jardin champêtre, issu de la réhabilitation d’une ferme historique — la Hofanlage Huntorf 1 — a été façonné à partir de 2006 par Ute et Albrecht Ziburski. Inspiré de la tradition des jardins naturalistes, il proposait des parterres luxuriants, composés majoritairement d’échinacées, d’héléniums et d’autres vivaces, soulignés par des haies élégamment taillées dans un style rappelant le travail du célèbre paysagiste néerlandais Piet Oudolf.
Le visiteur entrait dans un univers où le jardin ne se contentait pas d’être décoratif : il racontait une histoire, celle d’un paysage champêtre transformé en une œuvre vivante, évoluant avec les saisons et dialoguant avec l’architecture traditionnelle qui l’abritait.
Le Garden Moorriem : un jardin à l’âme poétique, aujourd’hui endormi
Le Garten Moorriem traduisait une subtile dualité entre rigueur et liberté. D’un côté, des volumes clairs et des lignes fortes — comme les colonnades de conifères ou les haies taillées avec précision — donnaient une ossature au lieu. De l’autre, un foisonnement de fleurs et de vivaces s’épanouissait en massifs souples et colorés, créant l’illusion d’une prairie naturelle.
Les images témoignent de cette harmonie : des allées sinueuses bordées d’échinacées roses et pourpres, un encadrement de conifères élancés qui ponctuaient la vue, et une profusion de graminées qui ondulaient au gré du vent. Le jardin vivait au rythme des saisons, offrant des floraisons vibrantes en été, des nuances flamboyantes en automne, et des silhouettes graphiques en hiver.
Fermeture, mais espoir de renaissance
Depuis 2020, le jardin a fermé ses portes. C’est une perte importante pour les passionnés qui venaient y puiser inspiration et émerveillement. Mais l’esprit du lieu n’a pas disparu : il continue d’habiter la mémoire collective et nourrit l’imaginaire de ceux qui l’ont visité. L’espoir demeure qu’un jour, il puisse de nouveau accueillir le public et transmettre cette poésie végétale qui lui est propre.




Inspiration personnelle : intégrer Moorriem chez soi
Le Garten Moorriem est un véritable manuel vivant du jardin naturaliste. Les images et les témoignages révèlent une composition extrêmement réfléchie, où chaque plante joue un rôle dans la couleur, la texture, la hauteur ou la saisonnalité. Voici une liste détaillée des principales associations possibles, inspirées de ce jardin.
1. Les floraisons estivales dominantes
- Échinacées (Echinacea purpurea, E. pallida, E. paradoxa)
- Couleurs : rose, mauve, blanc, parfois jaune pour certaines espèces.
- Hauteur : 70–100 cm.
- Saison : juin à septembre.
- Rôle : plante structurante, très présente au cœur des massifs, attire abeilles et papillons.
- Association idéale : avec des graminées légères (Stipa tenuissima) pour donner du mouvement.
- Héléniums (Helenium ‘Moerheim Beauty’, ‘Sahin’s Early Flowerer’)
- Couleurs : rouge brique, orange cuivré, jaune doré.
- Hauteur : 90–120 cm.
- Saison : juillet à septembre.
- Rôle : accent chaud et vibrant, crée un contraste puissant avec les tons froids.
- Association idéale : avec des rudbeckias jaunes pour renforcer la chaleur.
2. Les contrepoints flamboyants
- Rudbeckia fulgida ‘Goldsturm’
- Couleurs : jaune vif avec cœur noir.
- Hauteur : 50–70 cm.
- Saison : août à octobre.
- Rôle : tapis lumineux, véritable « couche d’or » dans les massifs.
- Association idéale : placé devant des héléniums rouges pour un contraste saisissant.
- Crocosmia ‘Lucifer’ et variétés orangées
- Couleurs : rouge écarlate, orange vif.
- Hauteur : 60–100 cm.
- Saison : juillet à août.
- Rôle : accent dramatique, jaillit au-dessus du feuillage.
- Association idéale : inséré parmi des tons pourpres et mauves (echinacées, verveines).
3. Les touches graphiques et aériennes
- Graminées ornementales
- Stipa tenuissima : chevelure souple, hauteur 50–70 cm.
- Calamagrostis acutiflora ‘Karl Foerster’ : verticalité nette, 120–150 cm.
- Miscanthus sinensis (variétés hautes et panachées) : 150–200 cm, floraison automnale argentée.
- Rôle : donner du mouvement, alléger les masses de fleurs, prolonger l’intérêt visuel en hiver.
- Verbena bonariensis
- Couleur : mauve translucide.
- Hauteur : 100–150 cm.
- Saison : juillet à octobre.
- Rôle : transparence aérienne, flotte au-dessus des massifs.
- Association idéale : en arrière-plan des échinacées ou devant des conifères vert foncé.
- Alliums ornementaux (Allium giganteum, Allium ‘Purple Sensation’)
- Couleurs : sphères violettes.
- Hauteur : 80–120 cm.
- Saison : mai à juin.
- Rôle : ponctuation verticale au printemps, crée un effet sculptural.
- Association idéale : avec des vivaces précoces (géraniums vivaces, népétas).
4. Les accents colorés tardif
- Eryngium planum (chardon bleu)
- Couleur : bleu métallique.
- Hauteur : 60–80 cm.
- Saison : juillet à septembre.
- Rôle : accent graphique, contraste sec et piquant.
- Association idéale : avec des tons chauds comme héléniums ou rudbeckias.
- Asters (Aster novae-angliae, A. novi-belgii, A. divaricatus)
- Couleurs : mauve, bleu, blanc.
- Hauteur : 80–150 cm selon variétés.
- Saison : septembre à octobre.
- Rôle : prolonger la saison, garder le jardin coloré jusqu’aux premières gelées.
- Association idéale : derrière des graminées pour un effet vaporeux.
- Anémones du Japon (Anemone x hybrida ‘Honorine Jobert’, ‘Königin Charlotte’)
- Couleurs : blanc pur, rose pâle.
- Hauteur : 90–120 cm.
- Saison : août à octobre.
- Rôle : élégance tardive, illumine les massifs ombragés.
- Association idéale : avec des tons plus sombres (sedums pourpres, persicaires).
5. Les arbustes et colonnes structurantes
- Thuja occidentalis ‘Degroot’s Spire’ ou ‘Smaragd’
- Port étroit et vertical, hauteur 2–3 m.
- Sert de colonne verte, ponctuation régulière dans les massifs.
- Cornus alternifolia ‘Argentea’ (cornouiller à feuillage panaché)
- Port étagé élégant, feuillage panaché crème-vert.
- Apporte une structure légère et une ombre graphique.
- Euonymus europaeus (fusain d’Europe)
- Baies rouges et orange à l’automne, feuillage flamboyant.
- Accent saisonnier fort, vu dans plusieurs photos du jardin.




Exemple d’association type « esprit Moorriem »
- Printemps : alliums violets + géraniums vivaces + feuillages naissants des graminées.
- Été : échinacées mauves + rudbeckias jaunes + héléniums orangés + verveine aérienne.
- Automne : asters mauves + anémones blanches + graminées dorées + fusains aux baies rouges.
- Hiver : silhouettes graphiques des graminées et des conifères persistants.
Composition végétale précise du jardin Moorriem
Le Garten Moorriem reposait sur une palette végétale soigneusement choisie, où chaque espèce jouait un rôle précis dans la composition.
Les échinacées (Echinacea purpurea) étaient les reines du jardin. Leurs grandes corolles dans des tons rose, mauve et blanc créaient un camaïeu vibrant et attiraient une multitude d’insectes pollinisateurs. Elles donnaient verticalité et légèreté, tout en assurant une floraison longue qui structurait l’été.
Les héléniums, et en particulier la variété Helenium ‘Moerheim Beauty’, apportaient une intensité visuelle unique. Leurs tons cuivrés et rouges, associés à leurs cœurs sombres, contrastaient avec les échinacées plus douces. Ils prolongeaient l’attrait des massifs jusqu’à l’automne, tout en offrant nectar et pollen aux papillons.
D’autres vivaces complétaient cette base : les rudbeckias jaunes éclatants, les liatris aux épis mauves, les crocosmiasflamboyants, ou encore les eryngiums métalliques qui ajoutaient une touche graphique. Pour donner souffle et mouvement, des graminées comme la Stipa tenuissima et le Calamagrostis ponctuaient les massifs, créant un contraste de textures avec les fleurs rondes et pleines.
Ce jeu subtil entre fleurs éclatantes, graminées aériennes et volumes structurés composait une véritable prairie ornementale contemporaine, à la fois libre et maîtrisée.




Un contexte historique et naturel local
La région de Moorriem, aujourd’hui rattachée à la ville d’Elsfleth, est profondément marquée par l’histoire et la nature. Depuis le Moyen Âge, ses habitants ont façonné ces terres marécageuses grâce aux digues et aux canaux, créant de longues parcelles agricoles typiques de la Basse-Saxe. Les vieilles fermes à colombages qui subsistent encore témoignent de ce passé paysan. Elsfleth, située au confluent de la Hunte et de la Weser, s’est développée grâce au commerce maritime et à la navigation. Ses chantiers navals et son école de navigation ont contribué à sa renommée et perpétuent encore aujourd’hui son lien avec l’eau.
Le paysage naturel, quant à lui, reste riche et fragile. Les marais, tourbières et prairies inondables qui entourent la ville abritent une biodiversité remarquable. Ils rappellent combien cette région est intimement liée à l’eau, à la fois ressource, menace et moteur de vie.
C’est dans ce cadre chargé d’histoire et ancré dans une nature singulière qu’a pris place le Garten Moorriem. Le jardin dialoguait avec son environnement, entre héritage paysan, poésie naturaliste et sensibilité contemporaine.




L’héritage de Garten Moorriem (et pourquoi on en parle encore)
Même fermé, le Garten Moorriem continue encore de marquer les esprits. Il a incarné un modèle de dialogue entre liberté et structure, où l’abondance des vivaces et des graminées rencontrait également la rigueur des haies et des conifères. Il a montré comment un jardin pouvait être vivant, changeant, mais toujours harmonieux.
Le Garten Moorriem reste aussi un symbole du style naturaliste contemporain, qui privilégie des plantations denses, vivaces, durables, favorisant la biodiversité et créant des paysages inspirés de la nature sans chercher à la domestiquer totalement.
Enfin, il demeure une source d’inspiration durable pour de nombreux jardiniers. Beaucoup ont retenu l’idée de renforcer leurs massifs par quelques éléments structurants, comme des thuyas élancés, et de laisser ensuite les vivaces exprimer toute leur liberté.
En somme, le Garten Moorriem n’est pas seulement un jardin disparu. C’est un héritage vivant, une leçon de composition et de sensibilité, une invitation à créer des espaces poétiques où structure et spontanéité s’équilibrent avec élégance.
Les images proviennent de: Carex tours, Astrid Guhl, Brigitte Bergscheider et Tony Spencer