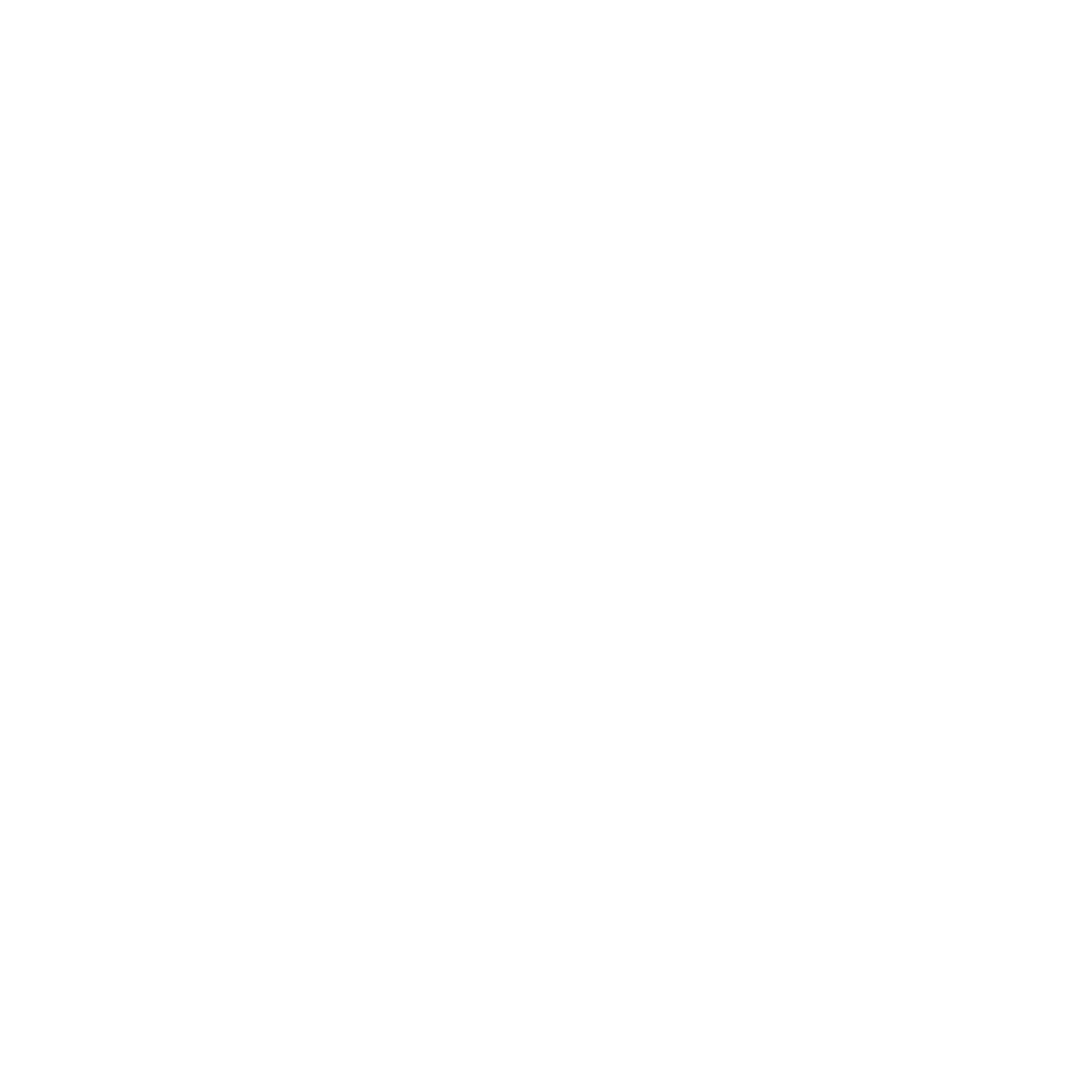La mante religieuse est un insecte fascinant, connu pour son comportement et sa capacité à chasser avec ses pattes ravisseuses. Bien que nous soyons habitués à les voir durant les mois chauds, sous leur forme adulte, on peut se demander ce qu’il advient d’elles pendant l’hiver. Les mantes religieuses, comme beaucoup d’insectes, ont des stratégies bien définies pour survivre au froid. Cet article explore en détail leur cycle de vie, en mettant l’accent sur leur survie pendant l’hiver et les moyens de les protéger à chaque étape de leur développement.
Le cycle de vie des mantes religieuses
Octobre et tout l’hiver : l’importance de l’oothèque
En octobre, à l’approche de l’hiver, les mantes religieuses adultes commencent à disparaître. Les mâles meurent souvent après l’accouplement, tandis que les femelles survivent juste assez longtemps pour pondre leurs œufs. Cependant, les mantes religieuses adultes ne passent pas l’hiver, laissant derrière elles leurs œufs protégés dans l’oothèque, une sorte de cocon qu’elles fabriquent à partir d’une mousse spéciale qui durcit au contact de l’air.
Qu’est-ce qu’une oothèque ?
L’oothèque est une capsule protectrice composée de plusieurs stries qui renferment les œufs de la mante. Chaque strie contient une série de « rayons », qui abritent des tubes remplis d’œufs. Ces œufs sont protégés pendant toute la période hivernale, souvent de sept mois ou plus. On peut trouver ces oothèques accrochées dans la végétation, sur des pierres, des arbustes, des volets, et parfois même sur les légumes dans un potager.


Comment protéger les œufs en hiver ?
La survie des œufs de mantes religieuses dépend de la préservation de l’oothèque pendant l’hiver. C’est là que les actions humaines peuvent souvent être involontairement néfastes. Le nettoyage des jardins et le rangement du mobilier d’extérieur à l’automne peuvent détruire ces précieuses oothèques. Il est donc essentiel d’adopter des pratiques de jardinage respectueuses de la faune en inspectant soigneusement les objets et les plantes avant de les déplacer ou de les nettoyer.
De plus, les oothèques sont souvent bien camouflées, ce qui les rend difficiles à repérer. Cependant, en sachant où chercher (dans les buissons, sur des piquets de jardin ou des fenêtres), il est possible de protéger les futures générations de mantes religieuses.
Juin : l’éclosion des œufs
Lorsque la température augmente au printemps, vers le mois de juin, les œufs éclosent et les jeunes mantes émergent. Ces petites mantes, appelées nymphes, mesurent à peine quelques millimètres à la naissance et sont des répliques miniatures des adultes, sans les ailes. Elles peuvent être de deux couleurs principales : brunes ou vertes. La couleur des mantes n’a rien à voir avec leur sexe, mais avec leur environnement immédiat. Les mantes brunes se camouflent mieux dans les herbes sèches, tandis que les mantes vertes se fondent dans l’herbe fraîche.
Durant cette phase, les jeunes mantes sont très vulnérables, non seulement au froid et aux intempéries, mais aussi à la prédation. Leur petite taille les rend des proies faciles pour d’autres insectes et animaux. Néanmoins, elles entrent rapidement dans la chaîne alimentaire du jardin et contribuent à réguler les populations d’insectes nuisibles.
Le rôle des mantes religieuses dans l’écosystème
En grandissant, les mantes religieuses deviennent des prédateurs redoutables, capables de chasser une variété d’insectes, allant des sauterelles aux chenilles. Ce rôle de prédateur généraliste en fait des alliées précieuses dans les jardins. En se nourrissant des insectes nuisibles, elles contribuent à maintenir l’équilibre des écosystèmes locaux.
Cependant, les mantes religieuses peuvent également capturer des proies plus grosses, comme des oisillons ou des chauves-souris, lorsqu’elles atteignent leur taille adulte. Ce comportement, bien que rare, montre leur polyvalence et leur adaptabilité en tant que chasseurs.
Juillet : les mues et l’apparition des ailes
Au fur et à mesure que les jeunes mantes se développent, elles passent par un processus appelé mue, au cours duquel elles se débarrassent de leur exosquelette pour grandir. Après cinq mues, elles acquièrent finalement leurs ailes lors de la sixième mue. Les ailes leur permettent de se déplacer plus facilement et de chasser de nouvelles proies.
À ce stade, les différences entre les mâles et les femelles deviennent plus apparentes. Les mâles, généralement plus petits et plus agiles, mesurent environ 4 à 6 cm, tandis que les femelles, plus grandes et plus lourdes, mesurent entre 6 et 8 cm. Les mâles ont des antennes longues et fines, tandis que les femelles ont un corps plus large et des antennes plus courtes. Cette différence dans la taille et l’agilité influence également leur comportement, les mâles étant souvent plus actifs dans la recherche de partenaires, tandis que les femelles restent proches du sol.
Août : la reproduction et la « femelle fatale »
En août, les femelles deviennent matures et entrent dans une période de reproduction intense. Pendant cette phase, les femelles deviennent souvent agressives, notamment envers d’autres femelles. Leurs affrontements spectaculaires incluent des vibrations d’ailes et des démonstrations de force impressionnantes.
Le comportement qui a le plus marqué l’imaginaire collectif est celui de la féminisation fatale. Pendant l’accouplement, il arrive que la femelle attaque et dévore le mâle, souvent en commençant par la tête. Malgré la perte de sa tête, le mâle continue de féconder les œufs. Ce comportement n’est cependant pas systématique : certains mâles réussissent à s’accoupler sans être dévorés, notamment en évitant les pinces de la femelle et en se retirant rapidement après l’accouplement.
Septembre : la ponte des œufs
Une fois les œufs fécondés, la femelle se consacre à leur ponte, qui marque la fin de son cycle de vie. Elle libère une mousse qui durcit pour former l’oothèque, où elle pond entre 200 et 300 œufs. Ce processus prend environ deux heures, après quoi l’oothèque durcit et devient résistante aux éléments naturels.
La période de ponte s’étend généralement de septembre à novembre. Une fois la ponte terminée, la femelle mourra quelques semaines plus tard, marquant la fin de son cycle de vie. L’oothèque, quant à elle, protégera les œufs pendant les mois d’hiver, jusqu’à l’éclosion du printemps suivant.

Les mantes religieuses en hiver
Les mantes religieuses adultes ne survivent pas à l’hiver. Elles finissent leur cycle de vie à la fin de l’automne, après avoir pondu leurs œufs. C’est l’oothèque qui assurera la survie de l’espèce pendant l’hiver. Pendant les mois les plus froids, les œufs resteront protégés dans cette capsule résistante aux intempéries.
L’un des plus grands défis pour les mantes religieuses est la destruction involontaire des oothèques par les jardiniers. En effet, beaucoup de personnes ne réalisent pas que les œufs de mantes peuvent se trouver dans les zones où ils effectuent des travaux de nettoyage. Le nettoyage de fin d’automne dans les jardins, notamment le retrait des feuilles mortes ou le rangement du mobilier, peut souvent entraîner la destruction des oothèques, mettant en péril la génération suivante de mantes.
Pour éviter cela, il est recommandé de laisser certains espaces intacts dans le jardin, comme les piquets de tomates, les feuilles mortes ou les buissons, qui peuvent servir de refuge aux œufs. En hiver, la faune sauvage dépend souvent des refuges naturels, et les mantes religieuses ne font pas exception.
La mante religieuse, bien que redoutée pour son comportement de chasseuse, est un insecte essentiel à la santé de nos écosystèmes.
Ainsi pour assurer leur survie, il est crucial de comprendre leur cycle de vie et de protéger les oothèques pendant les mois d’hiver. En adoptant des pratiques de jardinage respectueuses de la faune, en réduisant le nettoyage excessif des jardins à l’automne, et en sensibilisant les jardiniers à la présence des oothèques, nous pouvons contribuer à la préservation de cette espèce fascinante.
En prenant soin de l’habitat des mantes religieuses, nous aidons non seulement ces insectes, mais nous renforçons également la biodiversité dans nos jardins et nos écosystèmes locaux. L’hiver est une période cruciale pour les œufs des mantes religieuses, et en étant conscients de leur présence, nous pouvons les aider à revenir chaque printemps, prêts à jouer leur rôle dans la régulation des populations d’insectes.